Les Gardes suisses aux Tuileries, le 10 août 1792 : fidélité jusqu’à la mort
Le 10 août 1792 marque l’un des tournants les plus dramatiques de la Révolution française : la chute brutale de la monarchie. Ce jour-là, les Gardes suisses, défenseurs acharnés de Louis XVI, furent engloutis dans une tourmente de violence et de trahison. Leur sacrifice, d’une loyauté presque surnaturelle, a traversé les siècles, gravé dans la pierre du célèbre Lion de Lucerne.

Une garde d’élite, symbole d’honneur
Depuis le XVIᵉ siècle, les rois de France comptaient sur une garde suisse, issue des cantons centraux, réputée pour son courage, sa discipline et son inébranlable fidélité. En 1792, environ 900 Gardes suisses, installés à Paris, veillaient sur le roi et son palais : les Tuileries.
Le colonel en chef, Louis-Auguste-Augustin d’Affry, diminué par la maladie, ne put assumer le commandement ce jour décisif. La tâche revint à Karl Josef von Bachmann, qui suivit Louis XVI et sa famille jusqu’à l’Assemblée nationale, laissant le commandement sur place à un vétéran de confiance : le valeureux Capitaine Jost Dürler.

L’ordre fatal : « Cessez le feu »
Alors que la foule en armes s’amassait aux portes du palais, Louis XVI, dans une ultime tentative d’éviter un bain de sang, ordonna à ses troupes de cesser le feu et de se retirer. Cet ordre, parvenu de manière confuse aux combattants, sema désarroi et flottement parmi les défenseurs.
Face à l’incertitude, beaucoup de Gardes suisses firent le choix de rester fidèles à leur serment, prêts à tenir leur position, coûte que coûte. Dürler organisa une défense acharnée, mais la disproportion des forces était écrasante : une poignée de soldats contre une marée de plusieurs milliers d’insurgés déterminés à renverser l’ancien monde.
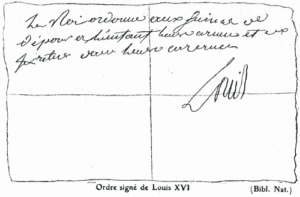
Le massacre des Tuileries
La bataille fut brève, sauvage, impitoyable. Les Gardes suisses furent taillés en pièces dans les cours et les escaliers du palais. Environ 600 périrent, tués au combat ou massacrés après leur reddition. Les rares survivants furent jetés en prison ou exécutés dans les jours qui suivirent.
Blessé, Jost Dürler parvint à échapper au massacre et rentra en Suisse, portant toute sa vie le poids de cette journée tragique.

Le Lion de Lucerne : un cri de pierre
En 1821, la Suisse honora la mémoire de ses fils tombés aux Tuileries avec une œuvre poignante : le Lion de Lucerne. Sculpté à même une falaise, ce lion mourant, transpercé d’une lance, incarne à jamais la bravoure silencieuse et la dignité dans la souffrance.
Au-dessus de lui, une inscription lapidaire : « Helvetiorum Fidei ac Virtuti » — « À la fidélité et à la bravoure des Helvètes ».

Un héritage éternel
Le 10 août 1792 n’est pas seulement une date de révolution : c’est une leçon d’éthique intemporelle. Celle de l’honneur, du sacrifice, de la fidélité poussée jusqu’à l’extrême.
Les Gardes suisses n’étaient pas de simples mercenaires : ils furent, en ce jour tragique, le dernier rempart d’un monde qui s’effondrait. Leur mémoire vit toujours, au creux de la roche de Lucerne et dans les cœurs épris d’histoire.

Les Adieux suisses : le chant de la fidélité éternelle
Le souvenir du sacrifice des Gardes suisses ne s’effaça pas avec la chute des Tuileries. En Suisse, une mélodie poignante, « Les Adieux suisses », continue encore aujourd’hui de porter la mémoire de ces hommes fidèles jusque dans les replis du cœur national.
Né dans la tradition militaire après les drames de la fin du XVIIIᵉ siècle, ce chant exprime la douleur du départ, l’amour de la patrie abandonnée, et la fidélité au devoir juré, même au prix de l’exil et de la mort. Chaque strophe résonne comme une prière mélancolique du soldat quittant sa terre natale, guidé par l’honneur.
Bien que son auteur demeure anonyme, « Les Adieux suisses » s’inscrit dans une tradition populaire profondément ancrée dans l’histoire helvétique.
Paroles
Les Adieux Suisses
Nous étions trop heureux, mon amie ;
Nous avions trop d’espoir et d’amour,
Nous croyions nous aimer pour la vie, (bis)
Mais, hélas, les beaux jours sont si courts. (bis)
Le bonheur dure trop peu sur la terre !
Entends-tu tout là-bas le tambour ?
Mon doux cœur, je m’en vais à la guerre, (bis)
Ne crains rien jusqu’à l’heure du retour. (bis)
L’ennemi a franchi nos frontières,
Il a pris nos maisons et nos champs.
Défendons le pays de nos pères, (bis)
Il faut vaincre ou mourir bravement. (bis)
Mes amis, si Dieu veut que je meure,
Retirez cet anneau de mon doigt.
Portez-le à ma mie qui me pleure, (bis)
Dites-lui : « cette bague est pour toi ! ». (bis)
Petite note historique
Ce chant émane du contexte du service militaire étranger, exercé dès le XVIIᵉ siècle par de nombreux Suisses, notamment au service du royaume de France. Il incarne la tristesse du départ, l’attachement viscéral à la patrie, et la fidélité jusqu’au sacrifice — thèmes qui prirent une dimension tragique après le massacre des Gardes suisses aux Tuileries, le 10 août 1792.
À travers ces vers simples et poignants, ce sont des milliers d’hommes, et parmi eux ceux tombés aux Tuileries, qui semblent adresser leur ultime salut, la voix tremblante d’émotion, mais le cœur résolu.
Aujourd’hui encore, « Les Adieux suisses » est chanté lors des cérémonies militaires, des hommages aux anciens régiments et des rassemblements patriotiques. Transmis de génération en génération, ce chant prolonge l’écho de la fidélité et du sacrifice.
À Lucerne, le monument du Lion blessé, taillé dans la roche, perpétue lui aussi cette mémoire : celle du courage discret, du devoir accompli et de la loyauté silencieuse.
Car le courage ne s’efface pas avec le temps : il vit dans la mémoire, dans la pierre, et dans la musique.
Les Adieux suisses sont également chantés par le 17ᵉ Régiment du Génie Parachutiste de l’armée française. Ils l’interprétèrent pour la première fois en 1983, dans la cour d’honneur des Invalides à Paris, lors de l’hommage national rendu à six de leurs camarades tombés sous les décombres d’un immeuble à Beyrouth.
Le début des Suisses en France
En 1515, à l’issue de la bataille de Marignan, François Ier signe avec les Suisses un traité de paix perpétuelle, prévoyant que ceux-ci fourniraient régulièrement des soldats au service du roi de France. Ce traité fut respecté pendant près de trois siècles, jusqu’à la chute de la monarchie française en 1792.
Sous l’Empire, quatre régiments d’infanterie suisses servirent dans les campagnes d’Espagne et de Russie. Sous la Restauration, deux des huit régiments d’infanterie de la Garde Royale (de 1815 à 1830) étaient également composés de Suisses.
En 1830, les régiments suisses disparurent de l’ordre de bataille de l’armée française. Toutefois, beaucoup de leurs anciens volontaires furent intégrés dans la Légion étrangère, fondée en 1831 par Louis-Philippe pour le service en Algérie.

